L’ODEUR DE LA VILLE MOUILLÉE de Marie Causse : ce qui meurt dans nos têtes
Paru le 7 mai 2012 - Éditions Gallimard (Collection L'Arpenteur)
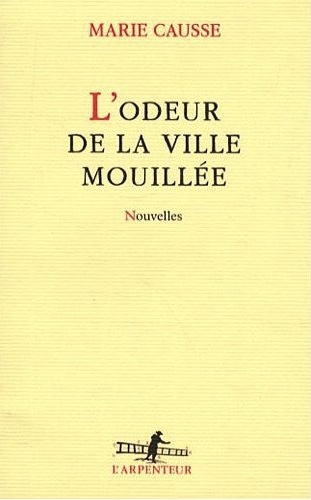
C’est une idée simple et forte, une façon d’assembler tant d’individualités au creux d’un même monde : nous sommes tous liés par la pluie. Immanquablement liés au temps qu’il fait, les événements qui ont marqué nos vies sont d’autant plus mémorables s’ils se sont accompagnés d’une bonne grosse averse ou d’un orage retentissant. La pluie réchauffe, pétrifie, détruit coiffures et maquillages, force à rester cloîtré, fait briller les yeux mais ternit les âmes. Puis elle s’arrête, laissant derrière elle de larges traînées humides et une odeur indéfinissable mais présente dans toutes nos consciences : ce parfum incomparable, c’est celui de la pluie.
Le lien pourrait sembler ténu, artificiel même, façon simpliste de tendre un fil rouge entre des nouvelles qu’on n’aurait pas su regrouper autrement. Il se passe pourtant autre chose dans le livre de Marie Causse : la pluie relie réellement les personnages et les textes entre eux, donnant une impression d’unité enveloppante et convaincante. Comme lorsque ce que le cinéma appelle vulgairement « film à sketches » se mue soudain en une galerie de portraits cohérente et inattendue, vaste radiographie d’une société trop vite qualifiée d’individualiste. Ces gens-là sont souvent seuls, condamnés à ne parler qu’avec eux-mêmes, gardant pour eux leur façon d’appréhender le monde. C’est ce monologue intérieur que retranscrit l’écrivaine, avec ce qu’il faut d’hésitations et de légères maladresses pour rendre palpable l’imperfection si touchante des personnages. De l’extérieur, ils ne ressemblent sans doute à rien d’autres qu’à des gens parfaitement ordinaires, la normalité incarnée, rien qui dépasse ou presque ; pourtant, à l’intérieur, les idées fourmillent, se développent parfois, puis meurent inexorablement faute d’oreille pour les recevoir ou de support pour les coucher.
Chez Marie Causse, ce qui meurt dans nos têtes devient l’essence même de nouvelles souvent modestes en apparence, mais dont la simplicité s’avère régulièrement très trompeuse. La plus belle est sans doute la onzième (sur dix-sept), intitulée La forme des nuages, dans laquelle un ancien sans logis rumine sa solitude dans un logement social, avec pour seul horizon une fenêtre par laquelle il observe et analyse les nuages qui se présentent à lui. À défaut d’être le plus représentatif, ce texte constitue le sommet du recueil par sa manière d’atteindre une dimension sociale supérieure en une poignée de mots, traduisant rage, frustration et désir refoulé de partage à travers une histoire à peine esquissée.
N’allez pas y chercher des intrigues échevelées et des rebondissements malicieux : L’odeur de la ville mouillée est avant tout affaire de captation, même si quelques imbroglios amoureux viennent se greffer à ces instantanés. Pourtant, le livre ne fait jamais de surplace : il gagne même en intensité dans sa seconde moitié, sans doute parce qu’on prend goût à la répétition de certains motifs ou de certaines idées noires. Mieux : le fameux liant évoqué plus haut fait réellement son office à la faveur d’un crescendo imparable et inattendu, comme si les nouvelles se répondaient entre elles en créant un écho insoupçonné et renversant. Dans cette ville non identifiée — on pourrait dire ces villes, mais l’impression d’unité est trop forte —, chaque personnage semble se nourrir des précédents et leur donner de l’ampleur.
L’écriture de Marie Causse est simple mais pas simpliste, directe et sans fanfreluche, effleurant élégamment ses personnages mais refusant de les juger. Aussi attaché aux humains qu’aux lieux dans lesquels ils évoluent, L’odeur de la ville mouillée est l’équivalent littéraire de Je suis une ville, l’un des chefs-d’œuvre de Dominique A., description d’un groupe d’hommes et de femmes à travers la peinture désabusée de leur environnement social.
« Je suis une ville dont beaucoup sont partis
Enfin pas tous encore mais ça se rétrécit
Il reste celui-là qui ne se voit pas ailleurs
Celui-là qui s’y voit mais à qui ça fait peur
Et celle-là qui ne sait plus, qui est trop abrutie
Qui ne sait pas où elle est ou qui se croit partie
Je suis une ville où l’on ne voit même plus
Qu’un tel n’est pas au mieux, lui qu’on a toujours vu
Avec les joues bien bleues, avec les yeux rougis
Ou avec le teint gris, mais bon, avec l’air d’être en vie
Un jour il est foutu et peu comprennent alors
Que la mort a frappé quelqu’un de déjà mort
Je suis une ville de chantiers ajournés
De fêtes nationales, de peu de volonté
De fraises qui prolifèrent le nez bien dans le verre
De retrouvailles pénibles car sur un pied de guerre
De visites écourtées ou dont on désespère
Je suis une ville couchée la bouche de travers
Parce qu’il y fait trop froid, parce que c’est trop petit
Beaucoup vont s’en aller car beaucoup sont partis
Il en revient parfois qui n’ont pas tous compris
Ce qui les ramène là et les attend ici
Ils ne demandent qu’à dire combien ils sont heureux
D’être là à nouveau, qu’on les y aide un peu
Qu’ils ne comptent pas sur moi pour les en remercier
On ne remercie pas ceux qui vous ont quittés
Qui reviennent par dépit et ne le savent même pas
Ils ne savent rien de rien et pourtant ils sont là
Et je suis encore fière et plutôt dépérir
Que de tout pardonner, que de les accueillir
Je suis une ville dont beaucoup sont partis
Enfin pas tous encore mais ça se rétrécit
Et je suis bien marquée, d’ailleurs je ne vis plus
Que sur ce capital, mes rides bien en vue
Mais mes poches sont vides et ma tête est ailleurs
Je suis une ville foutue qui ne sait plus lire l’heure
Qui a oublié l’heure
Qui ne sait plus lire l’heure
Qui a oublié l’heure »
La pluie décrite dans le livre possède en outre une caractéristique : elle se mêle habilement aux larmes qui coulent et les fait disparaître l’air de rien. Avantage ou inconvénient ? Pleurer discrètement, c’est ne pas dévoiler ses failles, rester vigilant sous l’armure, conserver chaque parcelle de dignité. Mais c’est aussi s’enfoncer encore un peu plus dans une existence fantomatique, une ascèse sentimentale terrifiante, qui continuera bien après la fin de cette pluie dont on humera encore une fois l’odeur pour se rappeler que l’on est vivant.