Histoire de l’argent d’Alan Pauls
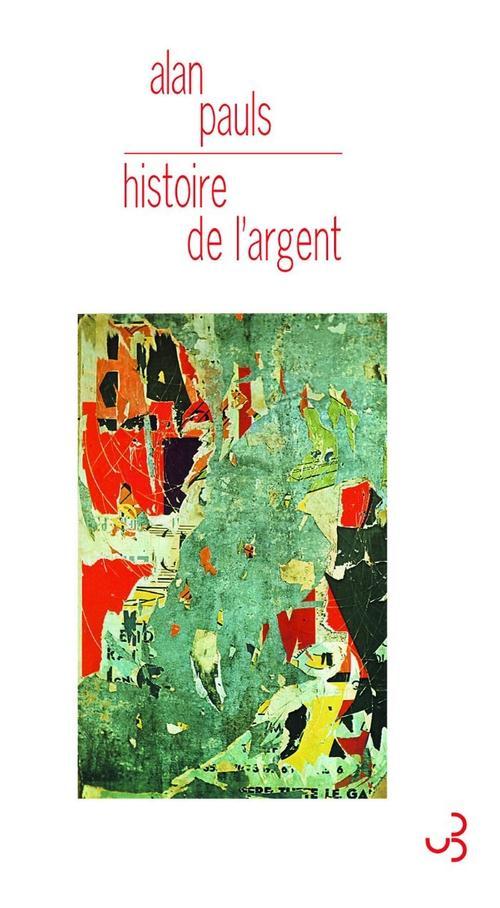
Il y avait eu l’Histoire des larmes. Avait suivi l’Histoire des cheveux. Avec Histoire de l’argent, le ténébreux Alan Pauls boucle une trilogie entamée il y a cinq ans, dans laquelle il fait le pont entre sa propre destinée et celle de son Argentine natale. Le lien est autrement plus ardu qu’une simple intégration de la petite histoire dans la grande Histoire : si les larmes, les cheveux et l’argent ont tant fasciné Pauls au long de ses derniers écrits, c’est parce qu’ils sont vus par l’auteur comme autant de prolongements du corps. Des prolongements qui, chez l’écrivain, peinent cependant à suivre un cycle pourtant programmé et acté depuis des millénaires. À son grand désarroi, le héros d’Histoire des larmes ne parvenait pas à pleurer, y compris dans les situations les plus potentiellement lacrymales de son existence. Celui d’Histoire des cheveux, lui, attachait une importance démesurée à sa coiffure, considérée comme un symbole fondamental — et donc très douloureux — de son positionnement politique dans une Argentine dévastée. Celui d’Histoire de l’argent, dès son plus jeune âge, voit l’argent quitter et regagner les mains de ses parents, disparaître de façon mystérieuse, et changer curieusement de valeur d’une seconde à l’autre, dans une mutation permanente et infernale qui ne cessera de le hanter.
Ces trois héros n’ont pas de nom, et pour cause : ils constituent très clairement trois ersatz de Pauls lui-même. Pour lui, ce ne sont d’ailleurs pas des romans, mais des fictions : façon de dire que ce “il” qu’il traîne de livre en livre, pronom impersonnel tellement chargé de sens, c’est lui et encore lui, toujours lui, qui peine à pleurer pour ce qui le fait vibrer, s’inquiète de son positionnement social à travers sa coupe de cheveux ou je ne sais quel autre détail, interroge son rapport à l’argent. Aucune intrigue à proprement parler dans ces trois oeuvres-là, juste un enchevêtrement virtuose et torturé d’anecdotes aux résonances psychiques inattendues, de détails qui bientôt n’en seront plus, de sensations de malaise qui s’étalent de plus en plus jusqu’à recouvrir des vies entières. À tort sans doute, le héros paulsien se sent toujours illégitime, condamné par son esprit d’analyse acéré à considérer le monde comme un gigantesque cactus sur lequel il est impossible de s’asseoir. Pauls est un Dutronc densifié, qui interroge Madame l’Existence mais se tient loin de chez Castel.
Histoire de l’argent recycle — ou plutôt décuple — les questions historiques sur la valeur de l’argent, sa signification profonde, son lien profond vis-à-vis de la mort. Zigzaguant sans prévenir des années 70 à nos jours au gré des souvenirs de plus en plus précis du héros, le livre épouse la trajectoire d’une Argentine sclérosée par les atrocités dictatoriales et toujours fragilisée par d’immenses soubresauts financiers. Il y a une dizaine d’années, un cinéaste argentin du nom de Fabián Bielinsky déboulait avec un premier film nommé Les neuf reines, somptueux portrait d’un arnaqueur arnaqué dont la déroute coïncidait avec une dévaluation surprise du peso. C’est cette même gifle économique qui anime le roman d’Alan Pauls, lequel s’amuse qu’un tas de jolies liasses de billets puisse faire à ce point rêver tandis que la même quantité de rectangles de papier, soudainement amassés dans des brouettes comme pendant la crise de 1929, soit synonyme d’une banqueroute assurée. Il y a toujours chez l’écrivain ce désir d’expliquer nos contradictions d’adulte par nos observations d’enfant. Les jeunes années du narrateur d’Histoire de l’argent ressemblent à un film noir minimaliste, une scène d’exposition sans développement, un florilège de mystères voués à rester sans réponse. Un membre de sa famille recomposée meurt noyé dans un fleuve dans un accident d’hélicoptère, abandonnant quelque part dans les fonds marins une valise pleine de dollars. Puis c’est son père qui crée à son tour le mystère chez l’adolescent, qui le voit s’évaporer autant de soirs que possible, tas de billets multicolores à la main, monticule de papelards qu’il semble chérir plus que tout. En vérité, le père joue au casino, jongle entre les créanciers qu’il amadoue grâce à de belles victoires ; mais ça, le gamin ne l’apprendra que plus tard.
Et c’est une évidence : pour Alan Pauls, le billet de banque est un pixel. Le nez dessus, on ne voit que sa couleur, drapeau monochrome qui ne semble vivre par celle-ci. Puis les années passent et le zoom arrière fait mal : les rêves d’enfant laissent place à un paysage composé tout entier d’argent, de devises qui fluctuent et nous échappent, petits édens qu’on voudrait palper à foison mais qu’on ne fait que toucher du doigt. Se dessine alors le principal paradoxe du héros, le nôtre à tous. Si les instants les plus terribles de sa vie sont dûs à l’argent — son absence, son insuffisance, son omniprésence —, il ne cesse de courir après. Drogue insipide qui ne fait effet qu’après avoir été transformée. Et le voilà qui s’interroge. Sur sa propre valeur, lui qui observe à demi-sidéré la façon dont les FARC fixent le prix de la vie de leurs otages auprès des pays avec lesquels ils négocient. Sur celle des autres, à travers le regard impitoyable et désabusé que porte son propre père sur ceux qu’il croise dans la rue, les qualifiant de “morts” ou de “vivants” en fonction de leur potentiel financier. Il lui suffit d’une interrogation très sérieuse sur sa mère (« À quel moment sa provocante beauté commence-t-elle à se faner ? Avec la dévaluation de juin 1975 ? ») pour prendre pleinement conscience que même lui, le moins cynique de tous, est incapable depuis trop longtemps de laisser l’argent en dehors de la moindre relation humaine, qu’elle soit intime ou non. Infoutu de verser la moindre larme si on l’identifie pleinement au héros de l’un de ses précédents livres, Alan Pauls finirait presque par nous en arracher quelques-unes tant il nous renvoie face à un reflet qui fait mal : celui du gamin innocent que nous avons été si peu de temps.
- La conjuration de Philippe Vasset par Catnatt
- Riviera de Mathilde Janin par Benjamin Fogel
- Les fuyants de Arnaud Dudek par Catnatt
- Histoire de l'argent d'Alan Pauls par Thomas Messias
- Le cas Eduard Einstein de Laurent Seksik par Catnatt
- Le Quatrième Mur de Sorj Chalandon - Retour à la tragédie par Anthony
- La méthode Arbogast de Bertrand de la Peine par Arbobo
- Le pyromane de Thomas Kryzaniac par Benjamin Fogel