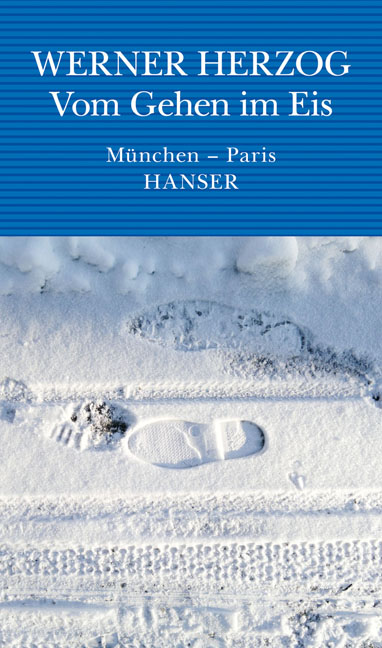Un jour, alors qu’il avait une trentaine d’année, Herzog apprit que son amie Lotte Eisner était gravement malade et risquait de mourir. Il décida alors de la rejoindre à pied, de Munich à Paris, convaincu que cet effort empêcherait tout malheur d’arriver. « Elle ne mourra pas, je ne le permettrai pas. »
Voilà pour le pitch du livre, et c’est ce que l’on trouvera de plus spectaculaire entre ces lignes : l’avant-propos expliquant ce projet d’enfant têtu, de sorcier, de pèlerin. Ensuite, on ne trouve que des notes éparses prises par Herzog tout au long de son austère voyage au seuil de l’hiver, qui ne nous épargne aucun détail sur les conditions météorologiques désastreuses, l’état de ses pieds, et les obsessions qui l’occupent immanquablement : où dormir, que manger. Les observations et pensées se succèdent d’une phrase à l’autre sans queue ni tête, balayées comme des nuages dans un paysage venteux. Noms de villages, forêts, routes. Litres de laits bus. Réminiscence d’une scène de film.
Pourtant, à travers ces lignes aussi monotones que son trajet, il nous donne à voir une posture face au monde qui entre en résonance avec son projet cinématographique. Au fil des détails recueillis dans ces pages, se dessine une attitude particulière, que l’on retrouve dans beaucoup de ses documentaires. Quand Herzog regarde le monde, que ce soit à travers un champion, un fou ou un handicapé, on dirait un enfant qui aurait attrapé un insecte et le contemplerait de derrière une vitre. Avec cette précision du regard, cet émerveillement qui semble si curieusement dénué d’empathie, il semble toujours chercher ce qu’il y a derrière l’humain, en-deçà ou au-delà, mais qui mène vers autre chose.
Ce qui l’intéresse, c’est la trajectoire. Que ce soit pour l’alpiniste qui dessine à pied son histoire sur les plus hautes crêtes du monde ou le sourd aveugle qui s’enfonce dans la solitude, il cherche toujours à se placer sur une frontière, à interroger ce moment où l’humain sort de l’humain. « L’homme est quelque chose qui doit être surmonté », prophétisait Zarathoustra en descendant de sa montagne.
Et c’est bien ce que l’on retrouve au grès des annotations qui constituent ce livre. En s’imposant un rythme de marche infernal, Herzog se pousse dans des retranchements où il devient animal, réduit aux plus simples besoin corporels, mais d’où il peut, au hasard d’un moment d’euphorie, devenir surhomme, géant engloutissant les kilomètres, un voyant aux sens déréglés qui perçoit l’harmonie secrète du monde. Car la signification de l’univers ne se dévoile que le temps d’une illumination, accessible aux idiots et aux héros seulement. Comme Kaspar Hauser, qui du fond de sa simplicité parvient à saisir la vibration qui le lie à son environnement.
« Quand je marche, c’est un bison qui marche. Quand je m’arrête, c’est une montagne qui se repose. » Ainsi, il se fait corbeau, cheval, chien, mammouth. Mais aussi roi, montagne, voyant, un Christ sans Dieu, à la souffrance sans adresse. Lui aussi, conquérant de l’inutile. Il va jusqu’à perdre sa figure d’homme, sa voix d’homme. De temps en temps, il vérifie dans un miroir qu’il a toujours un visage. Ceux des autres hommes l’inquiète.
Il voit des morts qui boivent le café dans une auberge abandonnée, un train qui prend feu et continue de rouler, un orchestre débattant au milieu de la route au lieu de jouer. Chez lui, l’absolu réalisme atteint au fantastique, comme si l’aspect hallucinatoire du monde était toujours présent, qu’il suffisait de se placer dans des conditions extrêmes pour y avoir accès. La volonté de puissance est au bout de la fatigue, de l’absolue solitude, du mutisme. C’est par l’obstination terre à terre, kilomètre après kilomètre, qu’il parvient à décoller.
S’il s’interroge un peu au début sur la santé de son amie, qu’il pense à son fils, etc., peu à peu l’univers se réduit à ces kilomètres à engloutir sous la pluie et la neige. Dans l’abandon absolu du paysage, il affute sa sensibilité, comme un mystique. Son voyage, longue succession de tempêtes et d’accalmie, le plonge dans une atmosphère sombre et humide, Orphée descendu aux enfers pour aller y chercher Eurydice. Et dans son épuisement, sa souffrance physique, on retrouve le verdict qui s’abat sur les sauteurs à ski de La Grande Extase du sculpteur sur bois Steiner : un par un, ils finissent broyés dans leur chute pour avoir voulu s’élever – ou deviennent des dieux. Grizzly man deviendra un ours ou sera dévoré. Il n’y a pas d’entre-deux.
Son écriture cherche elle aussi le moment de dérapage, le point de fuite qui fait déborder d’elles-mêmes ses considérations quotidiennes : « Ma cheville est enflée, probablement parce que, toute la journée, j’ai marché sur le côté gauche de la route goudronnée. Ainsi, le pied gauche se posait bien à plat, tandis que le droit se cambrait un peu à chaque pas, à cause du léger bombement de la route prévu pour l’écoulement des eaux. Tant que je passais à travers champs, je n’avais pas ce problème. C’est le noyau incandescent de la Terre qui brûle la plante des pieds. Aujourd’hui, l’isolement est encore plus intense que d’habitude. J’entretiens un dialogue avec moi-même. La pluie peut rendre aveugle. »